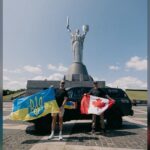Dans un rappel saisissant des dangers cachés de l’eau, l’île de Vancouver a enregistré 23 décès par noyade en 2023—une statistique qui a poussé les responsables de la Santé de l’Île à émettre des avertissements urgents sur la sécurité aquatique à l’approche des températures plus chaudes. Ce chiffre inquiétant représente une part importante des décès annuels par noyade en Colombie-Britannique, mettant en évidence un problème de sécurité régional qui exige une attention immédiate.
“Chacun de ces décès était évitable,” affirme Dr. Murray Fyfe, médecin hygiéniste à la Santé de l’Île. “Ce qui rend ces statistiques particulièrement déchirantes, c’est que la plupart des noyades surviennent lors d’activités récréatives, quand les gens sont censés s’amuser.”
Les données révèlent un schéma préoccupant: près de 80% des victimes de noyade sur l’île de Vancouver étaient des hommes, la majorité des incidents se produisant dans des plans d’eau naturels comme les lacs, les rivières et les environnements océaniques. Plus inquiétant encore pour les responsables de la santé publique, l’alcool ou la consommation de substances ont contribué à environ un tiers de ces décès.
Ces chiffres tragiques ont mobilisé une réponse coordonnée des autorités sanitaires locales et des organisations de sécurité aquatique. La Société de sauvetage de la C.-B. rapporte que la noyade demeure la troisième cause de décès accidentels chez les Canadiens, les enfants de moins de cinq ans et les hommes âgés de 15 à 44 ans étant particulièrement à risque.
“Nous observons une dangereuse combinaison d’excès de confiance, de sous-estimation des conditions aquatiques et d’altération du jugement,” explique Dale Miller, Directeur exécutif de la Société de sauvetage de la C.-B. et du Yukon. “La nature imprévisible des cours d’eau de l’île de Vancouver—avec leurs courants forts, leurs dénivellations soudaines et leurs températures froides—crée des dangers même pour les nageurs expérimentés.”
La Santé de l’Île a lancé une campagne complète sur la sécurité aquatique ciblant tant les résidents que les touristes. L’initiative met l’accent sur quatre stratégies de prévention essentielles: la surveillance, l’utilisation de gilets de sauvetage, la sobriété pendant les activités aquatiques et le développement des compétences en natation.
“Un gilet de sauvetage correctement ajusté est l’outil le plus efficace pour prévenir la noyade,” note la Gendarme Sandra Marleau de l’Unité maritime de la GRC. “Pourtant, nous constatons régulièrement que les adultes, particulièrement les hommes, résistent à les porter en raison de l’inconfort ou d’un sentiment d’invulnérabilité.”
Les municipalités locales réagissent à la crise en renforçant les mesures de sécurité dans les destinations de baignade populaires. Victoria et Nanaimo ont augmenté la présence de sauveteurs dans les zones de baignade désignées, tandis que Port Alberni a installé des équipements d’urgence supplémentaires dans les lacs situés dans les limites de la ville.
Pour les communautés autochtones de l’île de Vancouver, qui entretiennent des liens culturels profonds avec les cours d’eau locaux, des programmes éducatifs ciblés sont en cours d’élaboration, intégrant les connaissances traditionnelles aux pratiques de sécurité contemporaines. Ces approches culturellement adaptées visent à réduire les taux de noyade disproportionnellement élevés dans ces communautés.
L’impact économique des noyades va au-delà du coût humain incalculable. Selon les économistes de la santé, chaque décès par noyade représente environ 3,2 millions de dollars en coûts directs et indirects pour la société, incluant les interventions d’urgence, les soins de santé, la perte de productivité et les procédures juridiques.
À l’approche de l’été, les responsables de la santé soulignent que la prévention nécessite un effort communautaire. Les parents sont invités à inscrire leurs enfants à des cours de natation, les plaisanciers doivent s’assurer que l’équipement de sécurité est à bord et fonctionnel, et tous les utilisateurs d’eau devraient vérifier les conditions avant d’entrer dans tout plan d’eau.
“Nous devons changer notre attitude culturelle envers la sécurité aquatique,” insiste Dr. Fyfe. “Comprendre que les puissants plans d’eau exigent du respect n’est pas faire preuve de peur—c’est faire preuve d’intelligence.”
Alors que les résidents de l’île de Vancouver se préparent pour une nouvelle saison d’activités aquatiques, la question demeure: comment pouvons-nous collectivement transformer ces statistiques sobres en un catalyseur de changement comportemental qui préviendra les tragédies futures?