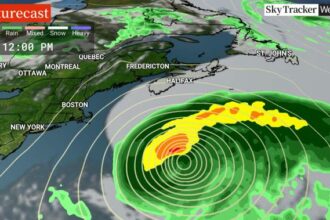Les couloirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sont devenus le champ de bataille inattendu d’une question fondamentale qui façonne notre identité nationale : qu’est-ce qui rend un contenu véritablement canadien? Alors que les régulateurs travaillent à moderniser le cadre du contenu canadien (« CanCon ») en vertu de la Loi sur la diffusion continue en ligne, un débat passionné a émergé sur la question de savoir si les éléments culturels devraient être obligatoires dans la nouvelle définition.
« Nous ne discutons pas simplement de cases réglementaires à cocher », a déclaré la présidente du CRTC, Vicky Eatrides, lors de l’audience de mardi à Ottawa. « Nous déterminons comment les histoires canadiennes seront racontées et préservées à l’ère numérique—une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. »
Le système actuel de certification CanCon, établi dans les années 1980, repose largement sur des points accordés pour l’emploi de Canadiens dans des rôles créatifs clés. Cependant, les critiques soutiennent que cette approche se concentre trop étroitement sur qui crée le contenu plutôt que sur ce que le contenu représente réellement des expériences, des perspectives et des références culturelles canadiennes.
Les parties prenantes de l’industrie ont présenté des points de vue nettement contrastés sur l’incorporation d’exigences culturelles. L’Association canadienne des producteurs médiatiques a plaidé pour des critères culturels spécifiques, arguant que sans eux, l’objectif même de la réglementation du contenu—préserver l’identité canadienne—devient vide de sens.
« L’absence d’éléments culturels minerait fondamentalement les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion », a déclaré Reynolds Mastin, PDG de l’ACPM. « Le Canada a besoin de contenu qui reflète nos diverses communautés, langues et expériences partagées—pas seulement de contenu réalisé par des Canadiens qui pourrait se dérouler n’importe où. »
Du côté opposé, les géants du streaming et certaines sociétés de production ont averti que l’obligation d’inclure des éléments culturels pourrait restreindre la liberté créative et la commercialisation mondiale. Un représentant de Netflix a soutenu que des « exigences culturelles arbitraires » pourraient forcer les créateurs à inclure des « références canadiennes superficielles » plutôt que de se concentrer sur une narration universelle capable de réussir à l’international.
Les audiences surviennent à un moment critique pour la politique médiatique canadienne. Alors que les plateformes de streaming mondiales continuent de dominer le marché, les diffuseurs canadiens traditionnels font face à une pression croissante pour rester compétitifs tout en remplissant leurs obligations en matière de contenu canadien.
Les représentants des médias autochtones ont souligné que toute nouvelle définition doit reconnaître et respecter les histoires des Premières Nations, des Inuits et des Métis comme intrinsèquement canadiennes. « Nos récits ne sont pas des ‘éléments culturels’ à ajouter ou à retirer—ils sont fondamentaux pour l’identité de cette terre », a affirmé la cinéaste Danis Goulet lors de son témoignage.
La décision du CRTC aura des implications considérables pour l’industrie de la production canadienne, évaluée à 9,3 milliards de dollars. Selon des données récentes du Fonds des médias du Canada, les productions certifiées canadiennes ont créé plus de 180 000 emplois équivalents temps plein en 2024 et généré une activité économique importante à travers le pays.
Le régulateur fait face à un délicat exercice d’équilibre : élaborer une définition suffisamment flexible pour permettre aux productions canadiennes de rivaliser mondialement tout en garantissant qu’elles demeurent authentiquement canadiennes de façon significative. Trop rigide, et les producteurs pourraient avoir du mal à obtenir un financement international; trop souple, et le concept même de contenu canadien devient creux.
Les audiences publiques se poursuivront jusqu’à la semaine prochaine, avec une décision finale attendue d’ici septembre. La nouvelle définition s’appliquera à la fois aux diffuseurs traditionnels et aux services de diffusion en ligne opérant au Canada, remodelant potentiellement ce que les téléspectateurs reconnaissent comme programmation canadienne pour les décennies à venir.
Alors que les téléspectateurs canadiens consomment de plus en plus de contenu sur de multiples plateformes et appareils, une question demeure au cœur de ces discussions techniques : à l’ère des médias mondiaux, que signifie pour une histoire d’être authentiquement canadienne, et qui devrait avoir l’autorité pour en décider?