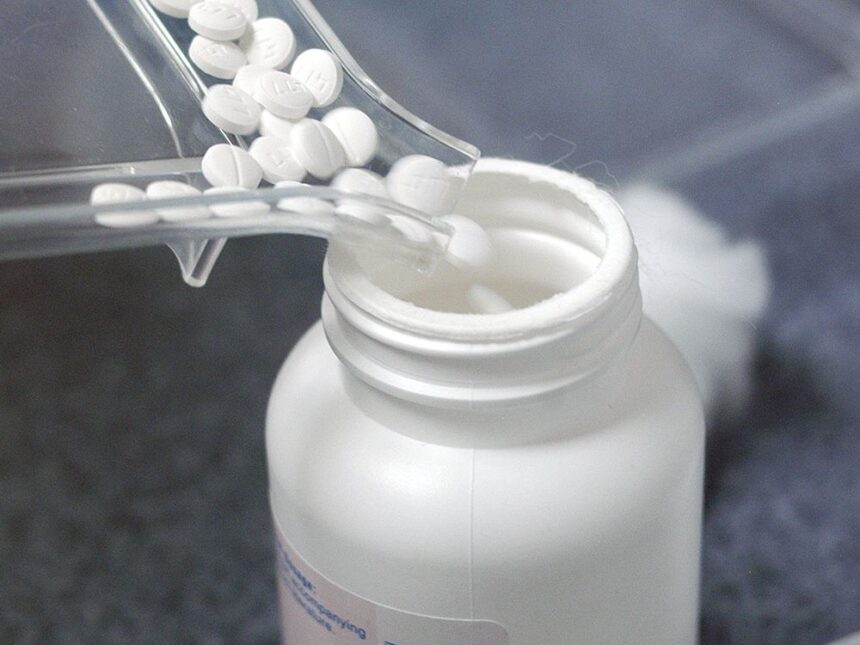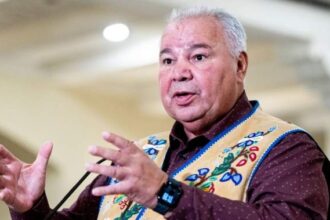L’industrie pharmaceutique canadienne se prépare à une perturbation significative alors que les promesses de campagne de l’ancien président Donald Trump concernant des tarifs douaniers généralisés contre son voisin du nord assombrissent l’avenir du secteur. Avec des exportations pharmaceutiques vers les États-Unis évaluées à environ 10,3 milliards de dollars par an, les acteurs de toute la chaîne d’approvisionnement médicale canadienne se retrouvent à naviguer dans des eaux de plus en plus incertaines.
“Il ne s’agit pas simplement d’équilibres commerciaux ou de postures économiques,” explique Dr. Elizabeth Chen, économiste en chef de l’Association pharmaceutique canadienne. “Nous parlons d’une chaîne d’approvisionnement médical nord-américaine intégrée qui, si elle est perturbée, pourrait affecter l’accès aux médicaments et leur abordabilité pour les patients des deux côtés de la frontière.”
Les inquiétudes découlent des récentes promesses de campagne de Trump d’imposer des tarifs d’au moins 10% sur toutes les importations canadiennes s’il est réélu, dans le cadre de sa stratégie économique plus large “L’Amérique d’abord”. Pour l’industrie pharmaceutique canadienne, qui a développé des relations manufacturières transfrontalières profondes au cours des décennies, de tels tarifs représenteraient un défi sans précédent.
L’impact potentiel s’étend au-delà des bilans financiers des entreprises. Selon une analyse de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto, les tarifs pharmaceutiques pourraient augmenter les prix des médicaments de 8 à 12% pour les consommateurs américains, tout en menaçant potentiellement plus de 25 000 emplois canadiens directement liés aux marchés d’exportation américains.
Les responsables canadiens ont déjà entamé des démarches diplomatiques, soulignant les avantages mutuels de la relation commerciale actuelle. Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a noté lors d’une conférence de presse à Ottawa la semaine dernière que “l’innovation pharmaceutique canadienne soutient la prestation des soins de santé américains d’une manière qui transcende les simples calculs commerciaux.”
Les représentants de l’industrie pointent plusieurs médicaments critiques où la fabrication canadienne joue un rôle crucial dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines. Les produits d’insuline, les traitements cardiovasculaires et certaines thérapies contre le cancer figurent en bonne place dans le commerce pharmaceutique transfrontalier, les installations de production étant souvent spécialisées pour des composés ou des mécanismes d’administration spécifiques.
“Nous avons passé des décennies à construire des capacités de fabrication complémentaires,” note Michael Brennan, PDG de BioPharma Canada. “Ce ne sont pas des relations qui peuvent être rapidement démêlées ou remplacées sans conséquences significatives pour les patients qui dépendent d’un accès constant aux médicaments.”
Les tarifs potentiels arrivent à un moment particulièrement difficile pour l’industrie pharmaceutique mondiale, qui s’ajuste encore aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement découlant de la pandémie et des tensions géopolitiques affectant l’approvisionnement en matières premières. Les fabricants canadiens ont souvent servi de partenaires fiables dans ce paysage incertain, avec des normes réglementaires étroitement alignées sur les exigences américaines.
Les analystes économiques suggèrent que le secteur pharmaceutique pourrait être particulièrement vulnérable aux impacts tarifaires en raison de sa nature hautement réglementée, ce qui rend l’adaptation rapide aux nouvelles barrières commerciales plus difficile que dans d’autres industries. Les processus d’approbation complexes pour les installations de fabrication et les exigences détaillées de contrôle de qualité signifient que le déplacement des lieux de production implique d’importants obstacles réglementaires.
Les gouvernements provinciaux à travers le Canada ont également exprimé leur inquiétude, particulièrement en Ontario et au Québec, où les grappes de fabrication pharmaceutique représentent d’importants employeurs et contributeurs économiques. Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a qualifié les tarifs potentiels de “contre-productifs pour la résilience des soins de santé nord-américains,” tandis que les responsables du développement économique ont commencé à planifier des mesures d’urgence.
Pour les entreprises pharmaceutiques canadiennes, les réponses stratégiques vont de l’accélération de la diversification vers les marchés européens et asiatiques à l’exploration d’une présence manufacturière potentielle aux États-Unis même – bien que cette dernière option présente des exigences d’investissement en capital importantes pendant une période déjà incertaine.
Alors que les deux pays s’enfoncent davantage dans leurs cycles électoraux respectifs, l’industrie pharmaceutique reste prise entre le nationalisme économique et les réalités pratiques des chaînes d’approvisionnement médicales modernes. La question qui se pose maintenant aux décideurs des deux côtés de la frontière: les ambitions politiques peuvent-elles être conciliées avec les interdépendances complexes qui en sont venues à définir les soins de santé nord-américains, ou les patients et les systèmes de santé sont-ils sur le point de devenir des dommages collatéraux dans un conflit commercial renouvelé?