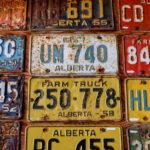Alors que le paysage politique évolue au sud de la frontière avec le retour au pouvoir de Donald Trump, le Canada se trouve à un carrefour crucial dans ses ambitions énergétiques propres. Le besoin d’un réseau électrique national cohérent n’a jamais été aussi évident, les experts avertissant que l’isolement provincial pourrait compromettre les objectifs climatiques du Canada et sa compétitivité économique dans un marché mondial de l’énergie en rapide évolution.
“Nous fonctionnons en silos énergétiques alors que nous devrions construire des ponts,” affirme Dre Melissa Chen, analyste de politique énergétique à l’Institut canadien du climat. “Un réseau électrique national n’est pas seulement une infrastructure—c’est une nécessité stratégique dans la réalité géopolitique actuelle.”
La fragmentation des systèmes électriques du Canada a créé une mosaïque de services publics provinciaux fonctionnant avec des interconnexions limitées. Alors que le Québec jouit d’un surplus d’énergie hydroélectrique, l’Alberta continue de dépendre fortement du gaz naturel. Pendant ce temps, l’Ontario fait face à des défis de demande croissante à mesure que l’électrification s’accélère dans les secteurs du transport et du bâtiment.
Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a récemment souligné cette préoccupation lors du sommet CO24 Politique à Ottawa. “Notre indépendance provinciale en matière d’énergie a servi certains intérêts historiquement, mais les changements climatiques exigent une coordination nationale. Nous laissons essentiellement l’électricité propre bloquée dans certaines régions tandis que d’autres brûlent des combustibles fossiles.”
Les implications économiques vont au-delà des objectifs climatiques. Avec les États-Unis susceptibles de revenir sur les incitatifs pour l’énergie propre sous l’administration Trump, des sources d’information canadiennes rapportent que les responsables gouvernementaux élaborent discrètement des plans d’urgence pour maintenir les flux d’investissement dans les secteurs canadiens des technologies propres.
Les analystes de l’industrie prédisent qu’un réseau national pourrait générer 50 milliards de dollars d’activité économique annuelle d’ici 2035 grâce à l’amélioration du commerce énergétique, à la résilience du système et à la capacité d’exploiter les forces régionales. La PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a noté dans une récente entrevue avec CO24 Affaires que “les services publics provinciaux commencent à reconnaître les avantages mutuels d’une intégration plus profonde, mais les barrières politiques demeurent obstinément persistantes.”
Ces barrières comprennent des questions de compétence constitutionnelle, des préoccupations concernant l’autonomie régionale et des arrangements complexes de partage des coûts. Les provinces atlantiques, particulièrement vulnérables aux impacts climatiques et à l’insécurité énergétique, ont défendu une plus grande intégration par le biais du projet de Boucle atlantique, qui pourrait servir de modèle pour des initiatives nationales.
Les communautés autochtones affirment également leur rôle dans les discussions sur le développement du réseau. “Toute approche nationale doit reconnaître les droits autochtones et incorporer des modèles de partenariat significatifs,” déclare le Grand Chef Wilton Littlechild, qui souligne que les corridors de transmission traversent souvent des territoires traditionnels.
Alors que les pays européens font progresser des marchés d’électricité intégrés malgré des rivalités historiques, les provinces canadiennes continuent de fonctionner comme des îles énergétiques. Le Danemark, par exemple, gère sa production éolienne de pointe en envoyant le surplus d’électricité à la Norvège, qui renvoie de l’hydroélectricité lorsque les vents danois sont calmes—un modèle qui pourrait s’appliquer entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.
Les enjeux vont au-delà des manchettes sur la politique climatique mondiale. Alors que les secteurs manufacturiers subissent des pressions pour décarboniser leurs chaînes d’approvisionnement, l’accès fiable à l’électricité propre influence de plus en plus les décisions d’investissement. Des entreprises comme Ford, General Motors et le producteur d’acier ArcelorMittal ont toutes cité l’accès à l’électricité propre comme facteur crucial dans leurs récentes décisions d’investissement au Canada.
Les propositions fédérales pour une norme d’électricité propre ont rencontré la résistance des provinces préoccupées par les calendriers de mise en œuvre et les coûts. Cependant, les partisans soutiennent qu’un réseau national réduirait en fait ces coûts grâce à une efficacité améliorée et au partage des ressources.
“Les provinces qui avancent en premier sur l’intégration verront les plus grands avantages économiques,” explique l’économiste Patricia Morrison de l’Université de Toronto. “Celles qui résistent pourraient se retrouver de plus en plus isolées à mesure que les investissements affluent vers les juridictions offrant une énergie propre et fiable.”
Alors que les responsables canadiens naviguent dans ces dynamiques complexes tout en se préparant aux changements de politiques américaines, la question fondamentale demeure : un pays construit sur l’autonomie provinciale peut-il surmonter les divisions historiques pour construire l’infrastructure énergétique nécessaire pour un avenir confronté aux défis climatiques? La réponse pourrait déterminer si le Canada atteint ses engagements climatiques et son potentiel économique dans une course mondiale à l’énergie propre de plus en plus compétitive.