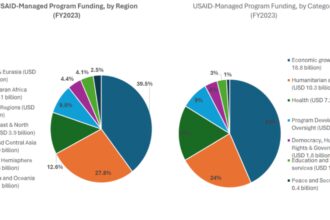Une révélation frappante qui remet en question les approches conventionnelles de conservation vient d’être mise en lumière par une étude internationale novatrice. Celle-ci a découvert que les liens culturels et spirituels avec les forêts pourraient être des moteurs de préservation plus puissants que les seules incitations économiques. Ce projet de recherche de cinq ans, couvrant 22 pays sur six continents, démontre que les communautés ayant des liens culturels profondément enracinés avec leurs terres forestières maintiennent systématiquement des écosystèmes plus sains malgré les pressions économiques croissantes.
“Ce que nous observons représente un changement de paradigme dans notre compréhension de la conservation forestière,” explique Dre Eleanor Richards, auteure principale et anthropologue environnementale à l’Université de Colombie-Britannique. “Alors que les décideurs politiques ont longtemps mis l’accent sur des solutions économiques comme les crédits carbone et les revenus du tourisme, nos données révèlent que le patrimoine culturel immatériel—histoires, traditions et pratiques spirituelles—offre souvent une base plus durable pour la gestion forestière.”
L’équipe de recherche a documenté plus de 300 études de cas où des communautés autochtones et locales ont maintenu des conditions forestières intactes pendant des générations grâce à leurs pratiques culturelles. Dans les Ghats occidentaux de l’Inde, des bosquets sacrés protégés par des traditions religieuses abritent des zones de biodiversité contenant des espèces menacées qu’on ne trouve nulle part ailleurs. De même, dans la région de Madre de Dios au Pérou, les communautés autochtones guidées par leurs connaissances ancestrales ont maintenu un couvert forestier à 98% alors que les zones environnantes ont subi une dégradation significative.
Ce qui rend ces conclusions particulièrement pertinentes est leur timing. Alors que les nations du monde entier luttent pour respecter leurs engagements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris, les approches traditionnelles axées principalement sur les instruments économiques ont donné des résultats mitigés. L’étude a révélé que les forêts régies par des systèmes de valeurs culturelles ont montré une résilience 37% plus grande contre l’exploitation forestière illégale, l’exploitation minière et l’expansion agricole par rapport aux zones gérées uniquement par des incitations économiques.
Dre Mei Wong, économiste de la conservation et co-auteure de l’Université Nationale de Singapour, note que les approches politiques modernes négligent souvent ces dimensions culturelles cruciales. “Nos modèles économiques ne parviennent généralement pas à saisir la profondeur des valeurs non monétaires que les communautés entretiennent. Quand les gens considèrent une forêt comme sacrée ou intégrale à leur identité, ils sont motivés par quelque chose de plus puissant que le gain financier.”
La recherche a également révélé une tendance préoccupante: les régions où les liens culturels traditionnels avec les forêts ont été rompus par le déplacement ou l’assimilation culturelle ont connu des taux de dégradation trois fois plus élevés que les zones où ces relations sont restées intactes. Ce modèle s’est avéré constant à travers des géographies radicalement différentes, des forêts boréales au Canada aux forêts tropicales en Indonésie.
“Ces résultats ne signifient pas que nous devrions abandonner complètement les approches économiques,” avertit Dr Kwame Osei, sociologue environnemental et contributeur à l’étude. “Ils suggèrent plutôt que nous avons besoin de modèles intégrés qui honorent et renforcent les relations culturelles avec les forêts tout en offrant des options de subsistance durables.”
Les implications vont au-delà de la science de la conservation. Les conclusions de l’étude influencent déjà la politique climatique internationale, plusieurs pays incorporant désormais la protection du patrimoine culturel dans leurs plans d’action climatique nationaux. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a cité cette recherche dans ses dernières recommandations pour atteindre les objectifs de développement durable.
Pour des communautés comme le peuple sami du nord de la Scandinavie, dont les traditions ont préservé de vastes étendues de forêt boréale pendant des siècles, ces résultats valident ce qu’ils savent depuis longtemps. “Notre relation avec la forêt ne concerne pas la propriété, mais la responsabilité et la réciprocité,” explique Elina Helander, une aînée sami qui a participé à l’étude. “Ces arbres sont nos ancêtres, nos enseignants, notre avenir. Ce n’est pas du folklore, c’est un système de connaissances sophistiqué qui nous soutient depuis des millénaires.”
Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent le mois prochain pour le Sommet international de la foresterie à Genève, cette recherche soulève une question profonde: avons-nous négligé notre outil de conservation le plus puissant en nous concentrant trop étroitement sur les solutions économiques plutôt que sur le renforcement des liens culturels entre les communautés et leurs forêts?